|
A
lire dans la revue d'octobre
2001 :
Le
sommaire
Archives
: revue d'avril 1999
de Jacques Seray
"La revue a vingt ans"
|
«
La Corse est la plus belle île du monde » disent les Corses
! Mais pour un insulaire, « son » île est toujours la
plus belle du monde ! Le mieux est d’aller sur place se forger sa
propre opinion.
Deux principales possibilités de randonnées permanentes
sont ouvertes en Corse aux cyclos randonneurs :
– le tour de Corse avec ses 1.000 km, 15.000 mètres d’élévation.
Il en fait largement plus que le tour et comporte donc quelques belles
incursions dans les massifs et pas mal de cols ;
– il y a aussi, plus récente, à ne pas confondre avec
le précédent, la randonnée des cols corses. 1.600
km vous attendent avec 155 cols et quelques 26.000 mètres d’élévation.
Pour satisfaire notre boulimie en la matière, c’est sur cette
seconde possibilité que nous avions depuis longtemps jeté
notre dévolu.
Quatorze
jours se sont écoulés. Le grand livre d’images vient
une nouvelle fois de se refermer. Le temps commence aussitôt son
œuvre destructrice, gommant avec obstination la précision
des souvenirs...
Jeudi 7 juin 2001, 11 h 30
Ajaccio, gare du chemin
de fer corse
Ciel bleu azur, chaleur
et brise de mer...
Voici
Fred. Docksides, Bermuda et T-shirt, il est exact au rendez-vous convenu.
Fred est toujours à l’heure ! Fred qui fut pendant la quinzaine
notre contact fiable sur place, assurant l’intermédiaire convenu
avec nos proches restés sur le continent. Fred aussi, préposé
à la garde de nos encombrants cartons à vélos, devenus
provisoirement inutiles à la descente du car-ferry.
Je n’ai jamais aimé les quais de gare, même pour des
retrouvailles. Aussi convenons-nous sans plus attendre de rejoindre la
marina du port de plaisance pour y déjeuner. Enfin un vrai repas
avec une entrée, un dessert, du temps à consommer sans retenue,
sans avoir les yeux rivés sur la montre, sans avoir à supporter
le regard inquisiteur et réprobateur de Patrick ! Patrick, ce goinfre,
cette horloge ambulante, prétend depuis longtemps que je mange
lentement. Il n’accorde aucun crédit à mon argument
d’un coefficient masticatoire un peu faiblard...
Bientôt installés au milieu de nombreux convives, voici l’étonnant
contraste de ce jeune homme parfumé, en tenue de ville estivale,
jambes blanches et pileuses, et de ces deux cyclistes. Eux, plus très
jeunes, exhibent leurs jambes rasées, bronzées, craquelées,
genre vieilles ex-danseuses du Crazy Horse. De leurs accoutrements colorés
s’exhalent aussi de fortes odeurs de bouc. Prévoyant une toujours
possible émeute de la part des clients « normaux »,
on nous a prudemment parqués à l’écart, disons
à une portée d’eau de toilette (« after-chèvre
»).
Premières bouchées, silence d’affamés, bruits
de mandibules dinosauriens... Fred, impatient, met fort habilement à
profit la conjonction d’un bref répit dans la mastication
et d’un intervalle laissé libre par le service entre le melon
glacé au porto et la darne de thon à l’oseille. Il
lâche : « Alors les mecs... vous racontez !... Comment ça
s’est passé ? J’attends... »
Le jeune serveur, toutes oreilles traînantes, accroche sur ces paroles,
s’arrête, inquisiteur...
Mais comment, en quelques mots, régurgiter (vocable en la circonstance
pas très adapté j’en conviens) ce que furent les faits
marquants de notre itinéraire ? Il y manquera toujours, de toutes
façons, les indescriptibles et fabuleuses odeurs du maquis, humide
dans la rosée du petit matin, ou chauffé à blanc
par Phébus au plénum de sa course...
Ami Fred, puisque tu insistes, je vais donc tenter de te relater l’essentiel
de ce que furent nos circonvolutions au travers des sept massifs (voir
la petite carte)...
 |
|
Vestige
de la Corse sésulaire :
l’antique pont
de Truggia, sur le torrent Liamone...
|
...L’affaire
commence
par Ajaccio
et le côté occidental...
Par temps calme, quand on arrive du large en Corse, une légère
brise souffle de terre, de la tombée du jour jusqu’à
l’inversion thermique de début de matinée. Elle est
porteuse des inoubliables senteurs déjà signalées.
Souvent, celles-ci sont perceptibles loin de la côte, bien avant
le lever du jour. Aujourd’hui le mécanisme des brises thermiques
est très faible, vraisemblablement parce que nous sommes encore
en système météorologique dépressionnaire.
Les odeurs sont par conséquent peu importantes. De nombreux foyers
orageux sont d’ailleurs visibles sur les reliefs. Ils s’amplifieront
en cours de journée, et nous courrons alors le risque d’être
arrosés.
La traversée de nuit Marseille-Ajaccio s’est effectuée
par mer calme, sans mal de mer, dans une cabine confortable. Ici, tout
est calme, loin du brouhaha marseillais du quai de la Joliette. Cette
ambiance générale apaisée nous incite à un
enchaînement rapide. Débarqués à sept heures,
frais et dispos, quelques exercices de clé à molette, deux
heures plus tard nous sommes en effet en route, après un dernier
petit noir à la terrasse d’un bistrot, en ta compagnie mon
cher Fred.
La première difficulté, très relative, la bocca (une
bouche en langue corse) de Stileto culmine à 71 m d’altitude
! Retenir comme « cols » toutes les bocca corses nous apparaîtra,
au fil du temps, comme une notion parfois discutable d’un point de
vue géographique. La notion de « bouche » pourrait
parfois avoir un sens plus nuancé, celui d’une échancrure,
d’une fenêtre, d’un passage.
Ce détour sémantique, destiné aux « cent cols
», aura au moins eu comme conséquence une erreur de parcours
après la bocca di Carrazzi (210 m), confirmant qu’en Corse
mieux vaut être vigilant et avoir une carte détaillée
disponible en permanence.
12 heures, faim ! Première expérience des possibilités
offertes par la restauration locale faite d’un genre de cassoulet,
abondant, associant saucisses corses et énormes haricots soissons.
Ce genre de met, intéressant au demeurant, nous sera proposé
d’autres fois. Néanmoins, vous serez déçu au
niveau des effets secondaires redoutés ou escomptés (c’est
selon les intentions de chacun). Rien ne se passe : on peut en déduire
qu’après un plat de soissons on ne gaze pas comme après
un plat de flageolets !
Mais à peine sommes-nous attablés « Chez Pépé
», à Sari-d’Orcino, aux prises avec nos flageolets et
autres figatellis, que le ciel se vidange. On nous questionne alors sur
nos intentions d’itinéraires. Comme nous signalons que c’est
vers le col de Verghio que s’orientent nos pneus, la réplique
est lourde d’énigmes : « alors courage... pour la pluie
et pour tout le reste... ». La pluie, on peut comprendre, elle tombe,
mais le reste ?
Dans la descente puis la remontée de l’infâme chaussée
conduisant à l’antique pont de Truggia, nous comprenons vite
l’allusion. D’abord médusés par ce premier contact
cahoteux, je constate vite que l’état général
des chaussées secondaires n’a guère évolué
depuis bientôt trente ans que je viens traîner mes congés
en île de Beauté. Pire, certains itinéraires, soit
par l’incurie des hommes, soit par effet de retour à la nature
(parc régional), soit par l’indigence des ressources financières
des communes, semblent en train de revenir à l’état
de pistes muletières.
Pour l’heure, si l’averse a cessé, l’inconvénient
de cette route pourrie s’augmente de la présence sur la chaussée
(ou ce qu’il en reste) de nombreux porcs en liberté, roses
et noirs, reniflards et sympathiques, jeunes cavalants en couinant aux
basques des mères. La plupart sont bâtardés de sangliers.
Nourris aux châtaignes, ils finiront comme principal constituant
de la savoureuse charcuterie corse. Vautrés sur la route, indifférents,
ils nous obligent parfois à mettre pied à terre. Visiblement,
nous ne sommes ni dignes d’intérêt ni prioritaires.
Nous sommes de passage, eux sont at home. La prudence, tout particulièrement
en descente, est de mise. Nous verrons plus tard que lorsqu’on ne
rencontre pas les cochons, inexistants dans certaines régions,
alors ce sont les vaches errantes qui les remplacent.
Après le bourg de Vico, le rude col en escaliers de Sevi (1.101
m) surprend sous la chaleur orageuse, avec 9 % de moyenne et deux kilomètres
à 14 %.
Cette première étape, forte de 2.600 m d’élévation,
sera la plus soutenue de la quinzaine.
Pour cette première nuit en terre corse, nous couchons au sommet
du facile col de Verghio (1.477 m, hôtel-refuge, station de ski).
Fait de lacets plutôt débonnaires, c’est le plus haut
col routier de « l’île de Beauté ».
 |
|
Visiblement,
nous ne sommes ni dignes d’intérêt, ni prioritaires.
|
A table,
de nombreux marcheurs engagés sur le GR 20 et quelques cyclistes
étrangers se côtoient. Nous partageons le repas avec un randonneur
pédestre haut-savoyard, échangeant à propos du GR
20. Il se trouve que j’ai pratiqué ce fantastique sentier
il y a une vingtaine d’années : j’ose utiliser ce superlatif
car, de mon point de vue, il le mérite. Très alpin et grandiose,
parfois même exposé, il se développe sur les crêtes
sommitales de l’île. Aucun espoir en VTT pour ceux qui y songeraient.
Le lendemain, le départ s’effectue dans un matin clair et
frisquet. Le monte Cinto (2.710 m), point culminant de la Corse, est bien
visible dans l’azur, couronné de neige de printemps. Nous
avons depuis le col basculé sur le versant est de l’île
et vers la région de Corte. Quarante kilomètres de descentes,
récompense du Verghio, nous attendent. Le passage des gorges de
la Scala de Santa Regina, échancrure de dix kilomètres dans
la roche, aussi éclatante qu’une œuvre d’art, est
un enchantement. On glisse...
Au-delà de Corte, le charme s’arrête. Finie la glisse.
La fraîcheur cède rapidement la place au temps orageux. Nous
sommes en Venaçais, dans la longue remontée vers la forêt
de Vizzavoma (col à 1.163 m), lieu d’un gigantesque incendie
l’an passé. La route fait des entrelacs constants avec la
pittoresque et acrobatique ligne de chemin de fer qui relie Calvi, Bastia,
Corte, à Ajaccio. Une excursion ferroviaire d’une journée
qui vaut la peine quand on a le temps.
Vers midi, dans la descente du col de Vizzavona, une pizza vite ingurgitée
nous permet un échange épistolaire avec les restaurateurs.
Il s’agit de recueillir leurs avis sur la validité de la représentation
d’un petit pointillé rouge et blanc sur la Michelin n°
90. La découverte d’un tel symbolisme sur une carte m’inspire
en général la méfiance. Il concerne le col de Scallela,
qui nous est à présent proposé pour rejoindre Bastelica.
Je renifle « un cadeau » de la part de Georges Rossini, concepteur
de la randonnée. Je m’attends à quelque chose comme
une grandiose mais infâme gargouille montante, cabossée et
tortillante, conduisant quelque part sur une crête aérienne
(1.193 m). « Les quatre derniers kilomètres sont défoncés,
vous devrez passer à pied... » Sur le terrain c’est
presque ainsi que les choses se concrétisent en effet. Sauf que
ces raides derniers kilomètres (entre 10 % et 14 %) sont toutefois
praticables à vélo : nous en avons vu d’autres. L’avis
des autochtones, certes utile, doit être considéré
avec recul. Ils manquent souvent de point de comparaison et ne connaissent
pas trop nos pratiques. Ils surévaluent ou sous-évaluent
les difficultés en toute innocence, au travers du filtre de leurs
propres valeurs.
Un fort orage qui n’était pas vraiment nécessaire,
nous rend les choses encore plus consistantes. Perdus dans les nuages
cotonneux, nous sommes rejoints au col par deux couples de retraités
en auto, tout surpris de trouver là, sous la pluie, deux cyclistes
en maillots, faisant la photo en plein brouillard. « Vous devez
être d’anciens coureurs, vu vos mollets ? », dit l’une
des dames.
A Cauro, étape tranquille : nous dînons avec un cyclo palois,
non assisté comme nous (espèce en voie de disparition).
Il effectue en dix jours et en solitaire le tour de Corse. Le voici arrivé
à la moitié de son parcours. Lui aussi a souffert des orages.
Patrick surenchérit « tu m’avais dit qu’en Corse
il fait toujours beau... ». Quoi ? J’ai dit ça moi ?
Petit intermède : la Corse est une zone de conflits climatiques
pouvant être violents. Elle est tiraillée entre cette mer
intérieure qu’est la Méditerranée et ses reliefs
accusés. Il serait abusif de s’imaginer pouvoir cycler en
montagne en toutes saisons. Si des périodes de grand beau temps
chaud peuvent certes survenir toute l’année, il faut aussi
considérer que les cols, jamais très hauts, ferment souvent
l’hiver et au printemps pour cause d’enneigement abondant.
En fait, il semble bien que le créneau utile pour un séjour
cycliste montagnard un peu long (quinze jours) soit assez étroit.
Nous avions choisi, renseignements pris auprès de Fred notamment,
la période de fin mai à début juin. Ce choix s’est
avéré adéquat pour cette année. En avril,
les cols peuvent subitement être bloqués (j’en ai fait
l’expérience par le passé). En été, il
fait vraiment trop chaud (sans parler de l’affluence des touristes
et de l’indisponibilité hôtelière). Reste septembre.
On nous a dit plusieurs fois : « mai-juin c’est l’époque
des cyclos », et effectivement nous croiserons de nombreux congénères
un peu partout.
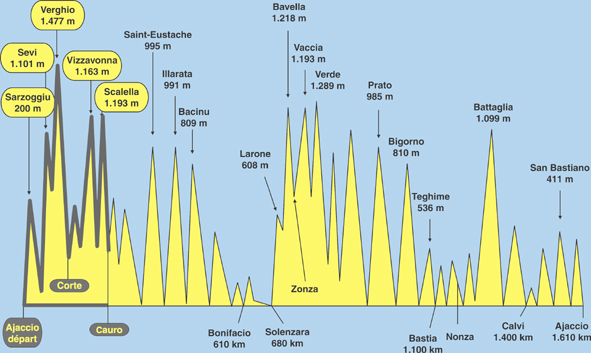 Daniel
JANAN. Daniel
JANAN.
(A suivre.)
|




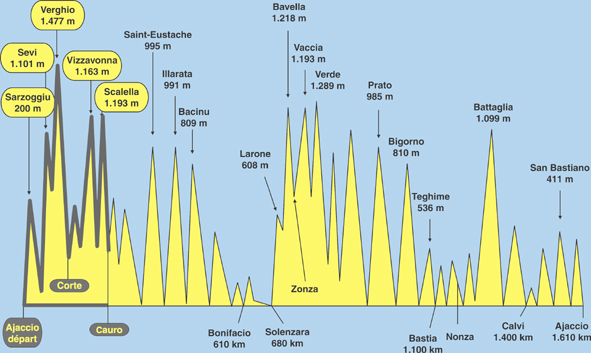 Daniel
JANAN.
Daniel
JANAN.